
Scène du déluge
Auteur : GERICAULT Théodore
Lieu de conservation : musée du Louvre (Paris)
site web
Date de création : 1819
H. : 97 cm
L. : 130 cm
Huile sur toile.
Domaine : Peintures
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
RF 1950 40 - 14-500198
Un Déluge comme métaphore de l’histoire
Date de publication : Décembre 2023
Auteur : Paul BERNARD-NOURAUD
Une Restauration qui peine à se remettre de la chute du Premier Empire
Après l’épisode des Cent Jours, la chute définitive du Premier Empire laisse un pays exsangue et divisé. Près d’un million de Français ont péri dans les guerres napoléoniennes. Jusqu’en novembre 1818, les alliés occupent près des deux tiers du pays. L’entretien de ces troupes incombe à la France, auquel s’ajoute le paiement de lourdes indemnités de guerre, selon les termes du Traité de Paris signé en 1815. Si Louis XVIII entend en renégocier les conditions, il ne peut les lever complètement. D’autant qu’il doit maintenir à tout prix la cohésion du pays. Les ultras, favorables au retour de la monarchie absolue, veulent prendre leur revanche sur les républicains et les bonapartistes. Le 14 février 1820, l’un d’eux assassine l’héritier putatif du trône de France, le duc de Berry, provoquant un nouveau raidissement en faveur du parti ultra et de l’absolutisme.
C’est dans ce contexte que Théodore Géricault, désormais considéré comme l’un des artistes modernes les plus en vue, avait présenté au Salon de 1819 ce que la censure avait présenté comme une simple Scène de naufrage (1818-1819, musée du Louvre), en laquelle chacun avait aussitôt reconnu le radeau sur lequel avait péri plus de cent-cinquante membres d’équipage de la frégate La Méduse en 1816, ne laissant qu’une dizaine de survivants. L’allusion à ce qui était alors devenu une affaire d’État en raison de l’incompétence du commandant de La Méduse et des tentatives d’étouffer l’affaire était transparente, et elle raviva la polémique au sujet du drame et de ses implications politiques. En exécutant à la même période une toile plus modeste, intitulée cette fois par le peintre lui-même Scène du déluge, Géricault semblait en apparence troquer le pamphlet politique pour l’allégorie biblique.
Un déluge aux allures de naufrage
L’atmosphère orageuse dans laquelle Géricault a plongé ses figures, traitant nuées, ondes et rochers du même ton bitumeux, rend l’action difficilement discernable à première vue. La trouée lumineuse qu’écharpent des trombes au lointain provoquerait même un contre-jour si elle n’éclairait au proche l’anatomie des figures. Cette logique de clair-obscur exacerbé est particulièrement frappante au premier plan. On distingue un homme de dos, s’extirpant de la mer, un autre de face, au visage obscurci, tendant un petit enfant agrippé à son cou à un couple paniqué à genoux sur les restes d’une chaloupe. Derrière eux, dans l’ombre, deux mains s’accrochent désespérément à une barque échouée à la verticale tandis que le reste du corps demeure sous l’eau. Entre les deux, à droite, un cheval tente de les rejoindre. Sur son dos une femme expire tandis qu’un homme la retient d’un bras et de l’autre s’agrippe à la crinière de leur monture.
Le naufrage comme modèle du déluge et le déluge comme métaphore de l’histoire
Tous ces éléments avaient déjà été rassemblés par Nicolas Poussin dans L’Hiver (vers 1660-1664, musée du Louvre), auquel le maître du classicisme avait donné des allures de déluge. Mais le drame y demeurait contenu, et Poussin n’avait pas cédé à l’ambiance de chaos que lui confère Géricault. Chez Poussin, les figures conservent aussi bien leur contenance que leurs costumes. La barque elle-même est intacte, faisant ainsi fonction d’arche. La figure qui s’y raccroche apparaît en partie émergée, annonçant de la sorte son sauvetage, voire son salut.
Chez Géricault, en revanche, point de salut. Sa Scène du déluge est d’autant moins biblique qu’elle apparaît plus vraisemblable que son modèle classique. Or cette vraisemblance tient au caractère historique qu’il lui donne, comme si le déluge devait désormais être représenté à la manière d’un naufrage. La peinture de naufrage avait connu au XVIIIe siècle un succès auquel reste attaché le nom de Joseph Vernet. Ce dernier s'était illustré dans le genre de la marine portuaire. Son petit-fils, Horace, spécialisé dans la peinture militaire, fut l’un des plus proches amis de Géricault avec lequel il partagea un temps son atelier parisien. Le paradoxe, pourtant, est que le traitement qu’il réserve à sa propre Scène du déluge s’inspire moins de cette tradition de la scène de naufrage qu’il n’investit celle-ci d’une historicité qui en décuple la puissance. Si Le Radeau de la Méduse ressemble à une scène de déluge, la Scène du déluge évoque quant à elle une scène de naufrage telle qu’il l’a interprétée dans Le Radeau de la Méduse : de façon moins mythologique qu’historique. Là où les spectateurs de la Scène de naufrage comprirent aisément en 1819 à quelle histoire le tableau faisait référence, de même ceux de la Scène du déluge pouvaient en comprendre tout aussi facilement la valeur métaphorique. Géricault y a peint sans le représenter le naufrage de la France. Mais un naufrage tel que seul un déluge lui est comparable. Comme l’a relevé Jean Sagne, la catastrophe que connaît la France depuis la débâcle de ses armées en Russie quelques années plus tôt n’est commensurable qu’à un événement diluvien. À l’appui de cette interprétation à la fois cryptée et transparente, Sagne signale que Géricault a peint sa Scène du déluge par-dessus une composition préexistante : une copie qu’il avait faite de la Bataille des Pyramides (1810, château de Versailles) d’Antoine-Jean Gros, toile qui commémore l’une des plus éclatantes victoires inaugurant la Campagne d’Égypte (1798-1801). Et Sagne d’en conclure que, symboliquement, « l’image de la défaite se superpose à celle de la victoire et l’efface. »
Alain CORBIN, Hélène RICHARD (dir.), La Mer. Terreur et fascination, Paris, Seuil, 2011.
Lorenz EITNER, Géricault. Sa vie, son œuvre, Paris, Gallimard, 1991.
Sylvain LAVEISSIERE, Régis MICHEL (dir.), Géricault, Paris, Réunion des musées nationaux, 1991.
Léon ROSENTHAL, Géricault, Paris, Librairie de l’art ancien et moderne, 1905.
Jean SAGNE, Géricault, Paris, Fayard, 1991.
Paul BERNARD-NOURAUD, « Un Déluge comme métaphore de l’histoire », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 06/01/2026. URL : https://histoire-image.org/etudes/deluge-metaphore-histoire
Découvrir l'analyse du Radeau de la Méduse de Panorama de l'art
Lien à été copié
Découvrez nos études

Le Congrès de Vienne
Le 30 mai 1814, l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie, après avoir triomphé ensemble pour la…



Louis XVIII, l'image d'un souverain moderne
La défaite infligée à Napoléon par les armées des puissances coalisées finit par provoquer son abdication en avril 1814. La…

Mort de Saint Louis devant Tunis
Présentée au Salon de 1817, l’œuvre de Georges Rouget, élève de Jacques Louis…

Le Roi Charles X visitant les peintures de Gros au Panthéon. 3 novembre 1824
Commandé à Gros par Napoléon, le décor de la coupole du Panthéon devait être composé de quatre groupes symbolisant les régimes…

La politique autoritaire de Casimir Perier
Casimir Perier (1777-1832) fut l’un des hommes politiques les plus en vue de la Restauration et des tout débuts de la monarchie de…
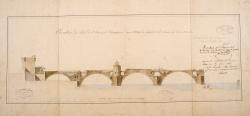
Le pont d’Avignon sauvegardé au XIXe siècle
Par la vertu d’une ronde enfantine, le pont Saint-Bénézet est sans doute le monument le plus célèbre de la Provence médiévale…



Jacques Cathelineau, général vendéen
L’insurrection vendéenne, déclenchée par Jacques Cathelineau en mars 1793, fut provoquée par le décret de la Convention du 24 février 1793 sur la…
![La France, […], reçoit de Louis XVIII la Charte constitutionnelle](/sites/default/files/styles/250xauto_zoom/public/2021-11/alf4_blondei_001f.jpg?itok=IFWLa3Jk)
La France, […], reçoit de Louis XVIII la Charte constitutionnelle
A la mort de Louis XVIII en 1824, son frère le comte d'Artois (1757-1836) accède au trône et porte jusqu’aux Trois Glorieuses le nom de Charles X…

Un Déluge comme métaphore de l’histoire
Après l’épisode des Cent Jours, la chute définitive du Premier Empire…

La Chute des Bourbons
Devenu roi le 24 septembre 1824 à la mort de son frère Louis XVIII, Charles X inaugure son règne par quelques mesures libérales, dont l’abolition…






Ajouter un commentaire
Mentions d’information prioritaires RGPD
Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel